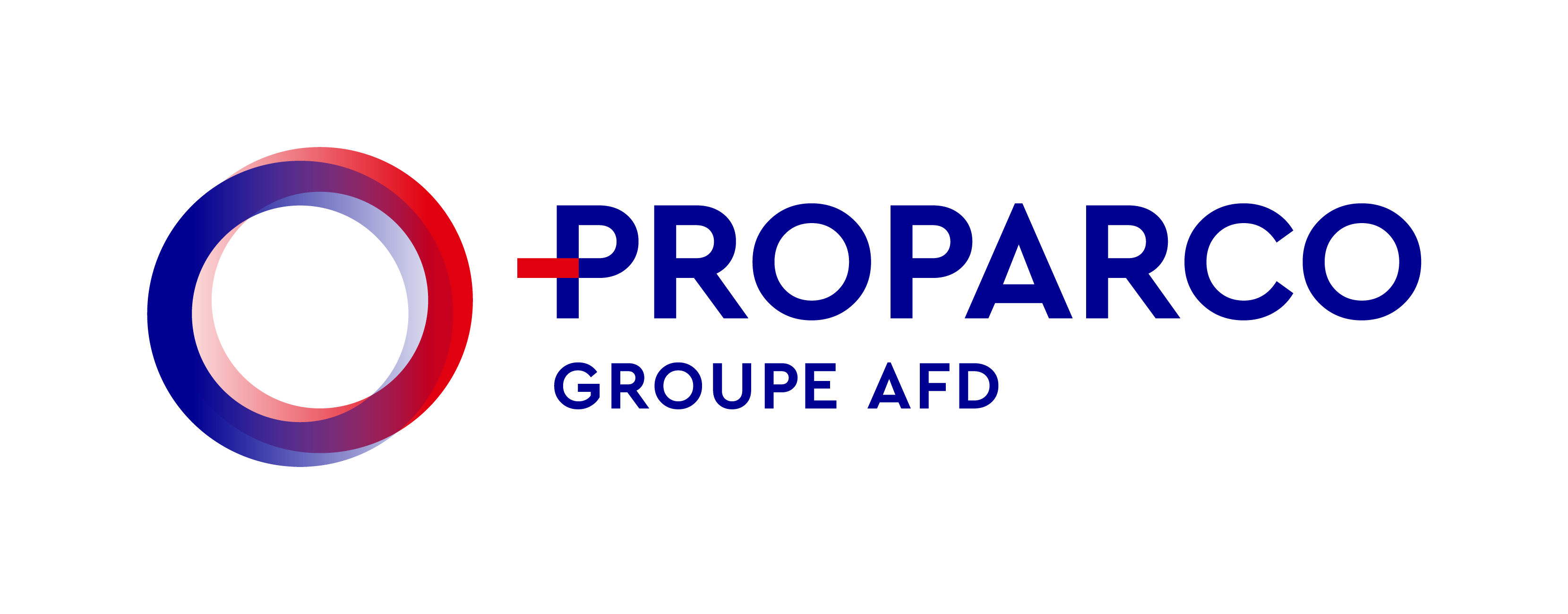Partager la page
Un partenariat public-privé pour remédier au risque de pénurie d’eau en Jordanie
Publié le
Tolga Ergüven Directeur financier de GAMA Enerji et membre du conseil d’administration DIWACO

Secteur Privé & Développement #42 - Accès à l’eau et à l’assainissement : le secteur privé à la source
Cette revue est consacrée au rôle du secteur privé dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. Un enjeu majeur alors que plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à une eau potable de qualité à domicile, et qu’elles sont 3,5 milliards à ne pas disposer d’un assainissement adapté.
Avec le soutien de l’AFD et de Proparco, DIWACO s’emploie à lutter contre la pénurie d’eau qui menace la Jordanie. Au vu des résultats obtenus, le projet suscite l’intérêt d’investisseurs et de banques commerciales, malgré le contexte de marché émergent et le risque politique qui le caractérisent. L’implication des institutions financières de développement (IFD) a été essentielle pour le financement du projet, mais aussi pour l’ensemble des aspects techniques, environnementaux, sociétaux et réglementaires.
EN QUOI CONSISTE LE PROJET D’ADDUCTION D’EAU « DISI », ET AVEC QUELS BÉNÉFICES POUR LA POPULATION D’AMMAN ?
Le projet Disi Water Conveyance (DIWACO) ambitionne de remédier à la pénurie d’eau en Jordanie. C’est un projet de type build-operate-transfer (BOT), conçu pour l’extraction de 100 millions de m3 d’eau par an, via un dispositif de 55 puits connectés à l’aquifère de Disi, qui se trouve sous le désert, dans le Sud de la Jordanie. L’eau est acheminée par des canalisations jusqu’à Amman, sur une distance de 325 kilomètres. D’une durée de vie de 50 ans, le projet approvisionne près du tiers de la population jordanienne. Il a joué un rôle essentiel pour le pays, en particulier face à l’afflux de réfugiés qui, en 2014, a ajouté 2,7 millions d’habitants à sa population.
EN TANT QU’INVESTISSEUR, QUE PENSEZ-VOUS DE CE PREMIER PPP DANS LE SECTEUR DE L’EAU ?
L’étroite collaboration entre le gouvernement, les promoteurs du projet et les prêteurs de premier rang a permis de surmonter des obstacles majeurs et de faire face aux principaux risques. Le projet fournit depuis 2021 des quantités annuelles supérieures à celles spécifiées dans le contrat, avec par exemple 115 millions de m3 en 2023. Les études de faisabilité en cours visent au demeurant à augmenter durablement la production à 120 millions de m3 par an d’ici 2026.
QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DES IFD DANS LE PROJET ?
La présence des IFD a facilité le dialogue politique avec le gouvernement jordanien, ce qui a abouti à une amélioration de l’environnement réglementaire et opérationnel, et donc un meilleur climat d’investissement dans le pays. Pour des projets d’infrastructures d’une telle ampleur, sur un marché émergent tel que la Jordanie, les sources de financement sont très limitées. L’implication des institutions financières de développement (IFD) dans le projet a donc été essentielle pour lever les fonds nécessaires. En outre, leurs apports dans le domaine technique, ainsi que sur les sujets environnementaux, sociétaux, réglementaires et juridiques ont joué un rôle déterminant dans la conception et la réalisation du projet.
CE TYPE DE PROJET EST-IL SUSCEPTIBLE D’ATTIRER DES BANQUES COMMERCIALES LOCALES OU INTERNATIONALES ?
Les banques commerciales se montrent généralement réticentes à financer des projets d’infrastructures de cette envergure, en particulier s’ils se situent dans des pays émergents, exposés à des risques géopolitiques. Mais du fait d’un montage de projet éprouvé et d’un bon historique d’exploitation, le projet suscite l’intérêt de plusieurs investisseurs, dont des banques commerciales locales et internationales pour une éventuelle participation au financement. Si on le compare à d’autres projets similaires, DIWACO est donc, à ce titre, absolument unique en son genre.
QUELS ÉTAIENT LES PRINCIPAUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET, ET COMMENT ONT-ILS ÉTÉ TRAITÉS ?
Le réseau de distribution parcours près de 400 km à travers le pays. Le projet emploie les habitants, dans toute la mesure du possible, pour assurer localement la sécurité des installations ou d’autres services liés au réseau de canalisations. En ce qui concerne les défis environnementaux, une analyse d’impact a été conduite de manière approfondie pendant la phase de construction. Elle est revue annuellement, et toutes les mesures nécessaires sont mises en oeuvre pour protéger les habitats naturels susceptibles d’être directement ou indirectement affectés par les activités de DIWACO.
QUELS ONT ÉTÉ LES DÉFIS TECHNIQUES DU POMPAGE DE L’EAU SUR 400 KM, DANS UNE RÉGION MONTAGNEUSE ET DÉSERTIQUE ?
Le projet a été mis en oeuvre dans un contexte géographique difficile, avec d’importantes contraintes logistiques. Le forage des puits exigeait notamment un ensemble de compétences supplémentaires, nécessitant souvent le recours à des techniques non conventionnelles, ce qui a pu occasionner des retards. Sur le plan opérationnel, en raison de la très grande longueur du dispositif, il est extrêmement compliqué d’assurer la surveillance d’éléments tels que les prises d’air ou les affouillements sur 200 km dans le désert. Nos équipes techniques s’en chargent avec le sous-traitant responsable de l’exploitation et de la maintenance, et en collaboration avec la police, qui surveille elle aussi la conduite aquifère et intervient en cas d’incident. Grâce à la pleine participation des populations locales, les temps d’arrêt sont généralement minimes.