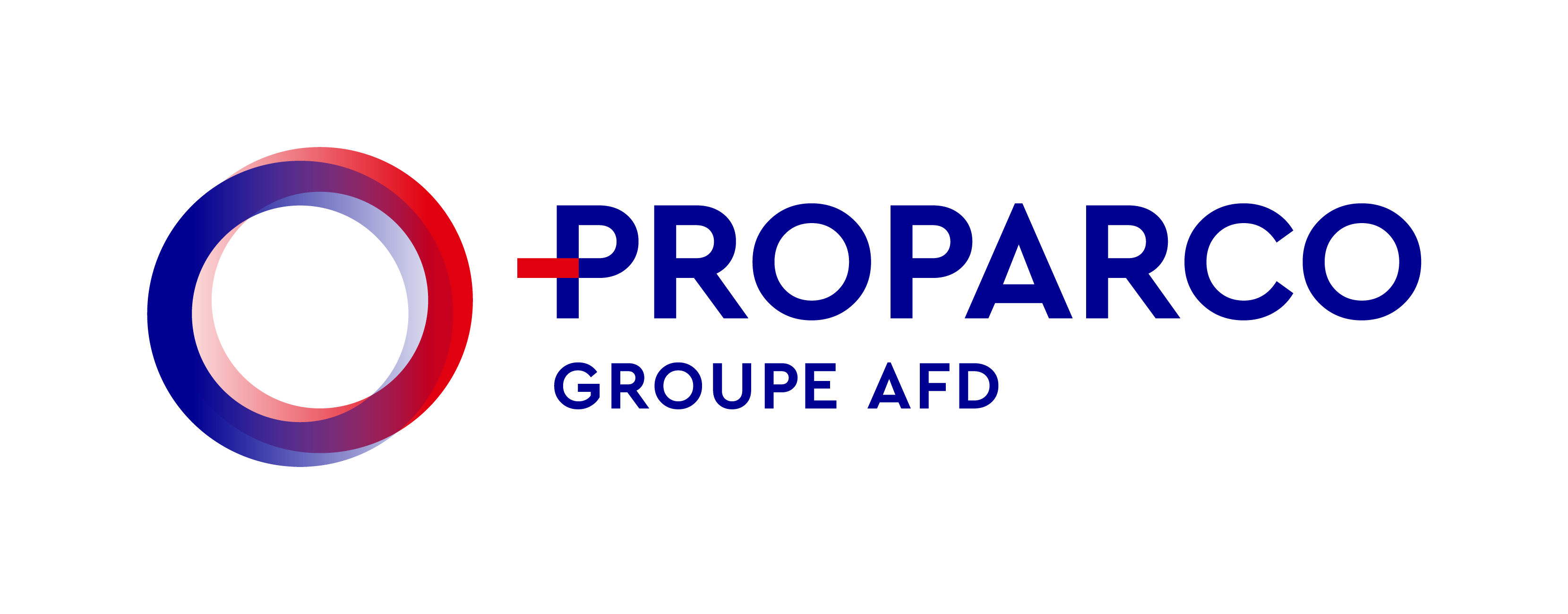Partager la page
Le défi mondial de l’eau potable et de l’assainissement : faire davantage et plus vite !
Publié le

Secteur Privé & Développement #42 - Accès à l’eau et à l’assainissement : le secteur privé à la source
Cette revue est consacrée au rôle du secteur privé dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. Un enjeu majeur alors que plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à une eau potable de qualité à domicile, et qu’elles sont 3,5 milliards à ne pas disposer d’un assainissement adapté.
Si les accès à l’eau potable et à l’assainissement sont clairement des droits humains, les besoins sont loin d’être couverts. Pour certaines populations, ils régressent même – car la croissance de la demande excède l’évolution de l’offre. Pour relever ce défi, il faut que la culture du résultat soit adoptée partout, que les différents acteurs du secteur parviennent à dépasser leurs intérêts propres au profit des objectifs collectifs, et que le financement favorise les « effets leviers » afin de permettre des actions bien plus nombreuses.
Le secteur de l’eau potable regroupe toutes les activités de prélèvement, de traitement et de distribution permettant aux utilisateurs d’eau d’en bénéficier selon leurs besoins. Le secteur de l’assainissement comprend toutes les activités de collecte, d’évacuation, de dépollution des eaux usées et des eaux de pluie et leur réutilisation après usage. Ces deux secteurs sont tellement importants pour l’humanité qu’ils font l’objet d’objectifs mondiaux ambitieux adoptés à l’unanimité par tous les pays en 2015 dans le cadre de l’Agenda 2030 et de ses Objectifs de développement durable (ODD). Au moins 8 des 169 cibles de ce programme mondial les concernent directement.
QUE SAIT-ON DE LA SITUATION MONDIALE ?
L’adoption de ces objectifs en 2015 a engendré une meilleure connaissance de la situation mondiale dans ces domaines. Les données par pays sont aujourd’hui en nombre suffisant pour avoir des estimations mondiales fiables. Pour certains ODD, ces informations ont pu être établies à plusieurs dates, ce qui permet de mesurer les progrès et de les comparer aux objectifs souhaités. Ainsi, pour l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement, nous disposons maintenant d’estimations solides des besoins actuels et des évolutions depuis 2015 au niveau mondial, par grandes régions, et pour de nombreux pays. En moyenne, le progrès est manifeste mais il est largement insuffisant. Cette moyenne cache même des reculs pour des parties importantes de la population.
Pour la dépollution, les informations sont encore insuffisantes pour juger des progrès mondiaux. On dispose enfin d’une estimation de la proportion mondiale des eaux rejetées par les populations qui ne sont pas dépolluées correctement avant rejet dans l’environnement (42 % en 2022 selon l’OMS3). Mais, on ne sait toujours pas si le total mondial des flux d’eaux utilisées par les populations et rejetées sans traitement de dépollution est en augmentation ou en diminution. Les données sont encore insuffisantes aussi pour avoir une estimation mondiale de la pollution rejetée par l’industrie. Par ailleurs, les indicateurs choisis pour les cibles des ODD 6.6 et 14.1 sont insuffisants pour mesurer les impacts des activités d’eau potable et d’assainissement sur les écosystèmes hydriques et marins.
Néanmoins, bien qu’encore limitées, les nouvelles connaissances statistiques constituent un progrès majeur. Pour les objectifs où l’évolution dans le temps a pu être estimée, les acteurs ne peuvent plus se satisfaire de beaux discours sur ce qu’ils font et sur les progrès qui en résultent. Ils sont maintenant confrontés à la réalité des besoins.
LE GRAND DÉFI POUR LES ACTEURS : AGIR PLUS VITE ET PLUS FORT !
Aujourd’hui, la plupart des différents acteurs font ce qu’ils peuvent avec leurs moyens et leurs contraintes respectives. De nombreux projets très positifs voient le jour, portés par des autorités publiques, des institutions financières, des acteurs économiques, des ONG ou des populations. Mais hélas, prises dans leur totalité, ces nombreuses actions ne suffisent pas. Elles ne répondent que partiellement aux besoins, surtout lorsque ceux-ci sont en augmentation : les croissances démographiques, urbaines et économiques font augmenter chaque année les besoins mondiaux en eau potable et en assainissement. Si les progrès ne sont pas assez rapides, le nombre de personnes sans accès satisfaisant à ces services peut augmenter au lieu de diminuer. C’est hélas ce qui est mesuré dans la moitié urbanisée de la population mondiale et aussi dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.
Cet écart entre réalisations et besoins est habituellement peu visible car chaque catégorie d’acteurs communique sur ce qu’elle fait de positif et peu nombreux sont ceux qui comparent la vitesse des progrès avec les besoins et encore plus rares sont ceux qui corrigent leurs actions en conséquence. L’écart très important dans certains domaines ne se réduit que lentement. S’il va même en augmentant pour certaines populations, ce n’est pas par inaction, mais parce que le rythme des réalisations est inférieur au taux de croissance des besoins.
Le défi collectif mondial pour les acteurs de l’eau et de l’assainissement est clair : il leur faut faire davantage et plus vite. Il faut passer d’un monde où les nombreuses parties prenantes du secteur de l’eau sont satisfaites de leur bon travail à un monde où l’on répond effectivement à l’importance des défis liés à l’eau potable et à l’assainissement. Cela suppose de se fixer des objectifs nationaux et locaux plus ambitieux, de mobiliser davantage de moyens humains et financiers et de lever de nombreux obstacles. Pour de nombreux décideurs, cela signifie aussi de passer d’une culture de moyens, « je fais ce que je peux avec les budgets qu’on me donne », à une culture du résultat, « je recherche les moyens humains et financiers de toutes natures qui permettront l’obtention des résultats qu’on me demande ». Cette culture du résultat est au cœur de l’Agenda 2030 qui définit les objectifs mais sans indiquer de chemin. Les moyens sont laissés au choix de chacun.
Depuis 2010 et la reconnaissance par l'ONU des accès à l’eau potable et à l’assainissement comme étant des droits humains, les autorités publiques ne peuvent plus se contenter de faire le maximum dans la limite de budgets arbitrairement choisis. Elles ont l’obligation d’obtenir un résultat : faire en sorte que toute leur population ait un accès satisfaisant à l’eau potable et à l’assainissement en mobilisant les moyens nécessaires. Ce changement de rôle des autorités publiques a été traduit dans la législation de l’Union européenne en 2020.
LE SECTEUR PRIVÉ EST CONCERNÉ DE MULTIPLES FAÇONS
Les autorités publiques sont évidemment concernées au premier chef par ces besoins d’accélération des réalisations sur le terrain et d’acquisition de la culture du résultat conforme aux objectifs. Mais le secteur privé est également impliqué car il contribue à satisfaire les besoins en eau potable et en assainissement des populations, que ses membres concourent aux actions publiques ou à des actions privées les complétant.
Plusieurs catégories d’acteurs privés interviennent dans le secteur de l’eau. Ils ont chacun leurs contraintes. Les fabricants de tuyaux, de pompes, de matériels et de produits nécessaires aux infrastructures d’eau potable et d’assainissement, ainsi que les constructeurs de ces infrastructures, doivent assurer la durabilité et la facilité de maintenance de leurs équipements. Ils doivent aussi innover et optimiser pour abaisser les coûts, prévoir des équipements adaptés à la grande diversité des situations concrètes, anticiper les impacts de tous les changements comme le réchauffement de l’eau, l’émergence de nouveaux polluants ou l’évolution des besoins et usages, etc. Les opérateurs privés régulés agissent à la demande et sous le contrôle des autorités publiques, la plupart du temps sous la forme de contrats de partenariats public-privés (PPP). Comme les opérateurs publics qui font le même métier, ces acteurs privés doivent s’adapter aux variations en qualité et en quantité des ressources en eau, à l’évolution des besoins et des usages, à l’émergence de nouveaux polluants, au besoin de desserte des populations sans accès satisfaisant, aux différentes demandes sociales et aux changements climatiques. Les opérateurs privés de services non régulés ou faiblement régulés jouent aussi un rôle important dans ce secteur : distributeurs d’eau par camions-citernes ou bidons, fabricants et distributeurs d’eau en bonbonnes, etc. Sans oublier bien entendu les vidangeurs qui évacuent les contenus des fosses d’assainissement individuel et doivent respecter des normes environnementales précises.
Les banques privées sont essentielles pour les acteurs du secteur de l’eau, car elles leur permettent de résoudre l’écart temporel entre leurs décaissements et leurs encaissements et de financer des investissements de long terme. Il est important qu’elles répondent mieux aux besoins de financement des opérateurs publics et des acteurs privés. Les distributeurs d’électricité doivent, eux, alimenter prioritairement et continûment les infrastructures d’eau car sans électricité, les pompes ne peuvent fonctionner et les services d’eau s’arrêtent. Des associations et organisations à but non lucratif locales ou internationales peuvent créer et faire fonctionner des infrastructures d’eau potable ou d’assainissement. Enfin, les bureaux d’études analysent les problèmes, conseillent les pouvoirs publics, conçoivent des projets et participent au contrôle de leur réalisation. Tous ces acteurs privés doivent s’adapter aux évolutions de leurs marchés respectifs. Si on y ajoute la partie opérationnelle des opérateurs publics et les services publics de contrôle, on obtient l’ensemble de l’écosystème de l’eau potable et de l’assainissement. Ses membres sont complémentaires et agissent de façon plus ou moins régulée sous la direction et le contrôle des autorités publiques.
LE RÔLE DES AUTORITÉS PUBLIQUES ET DE LEURS INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Pour que l’ensemble de cet écosystème produise davantage de services, il est d’abord nécessaire que les autorités publiques leur fixent des objectifs plus ambitieux dans le cadre de politiques publiques de long terme centrées sur l’atteinte de résultats et corrigées régulièrement en fonction du rythme des progrès obtenus.
Mais les acteurs de cet écosystème ne pourront atteindre collectivement ces objectifs que s’ils peuvent avoir des moyens financiers et humains suffisants, et uniquement si les obstacles et freins internes contraignant ces moyens, résultant d’intérêts divergents, de manque de confiance dans les autres partenaires ou de régulations insuffisantes, sont surmontés. Par exemple, pour mieux répondre aux besoins, plutôt que de chercher à les financer seuls, il est important que les pouvoirs publics et les institutions financières permettent le financement d’un plus grand nombre d’investissements « par effet de levier ». Pour cela, il faut crédibiliser les projets d’investissements des opérateurs locaux publics et privés et créer davantage de confiance entre les acteurs et sur les marchés financiers. Cela favorisera la baisse des taux des prêts « commerciaux », souvent inadaptés à des investissements de très long terme.
Lever tous ces freins ne suffira pas. La situation ne s’améliorera significativement que si ces services essentiels deviennent clairement prioritaires pour le monde politique et les décideurs. Aujourd’hui, à parité de richesse par habitant, certains pays en développement consacrent deux fois moins de moyens financiers (budgets publics et financement par les utilisateurs) à l’eau et à l’assainissement que d’autres !
Depuis quatre ans, ONU-Eau communique largement sur le besoin d’accélération des politiques publiques d’eau et d’assainissement mais sans effet probant à ce jour. Aucun changement de rythme n’a été décelé. Pas facile, car cela remet en cause de nombreuses habitudes et de nombreux équilibres politiques.
Et pourtant, éviter que des milliards de personnes manquent encore d’eau potable ou d’assainissement dans plusieurs générations nécessite d’agir bien plus vite et bien plus fort en dépassant les seuls intérêts à court terme des différents acteurs. Un sursaut collectif est indispensable, au plus tard lors de la deuxième Conférence ONU sur l’Eau de décembre 2026.