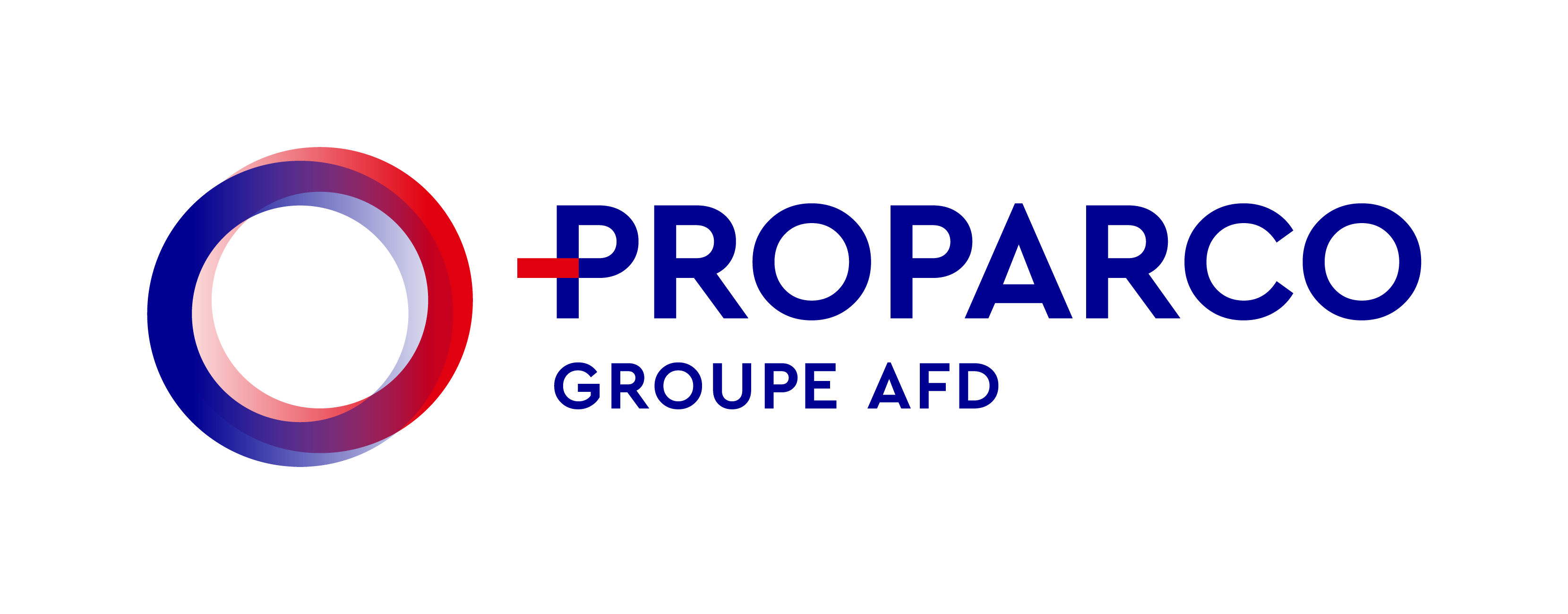Partager la page
De l’eau potable pour les zones rurales et semi-urbaines en Afrique : la nécessaire implication du secteur privé
Publié le
Mikaël Dupuis Directeur adjoint UDUMA

Secteur Privé & Développement #42 - Accès à l’eau et à l’assainissement : le secteur privé à la source
Cette revue est consacrée au rôle du secteur privé dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. Un enjeu majeur alors que plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à une eau potable de qualité à domicile, et qu’elles sont 3,5 milliards à ne pas disposer d’un assainissement adapté.
Historiquement considéré comme non rentable, le secteur de l’eau potable en milieu semi-urbain et rural en Afrique n’a jamais vraiment suscité l’intérêt du secteur privé. Pourtant, plus de 50 % de la population du continent est concernée, démontrant ainsi l’existence d’un marché important. Certes, la mise en place de services d’eau potable pérennes reste un défi dans ces régions et l’implication du secteur privé doit être adaptée aux réalités locales. Mais il est possible de développer des services rentables, durables et équitables en tenant compte des contraintes économiques, en établissant un cadre réglementaire adapté et en développant des outils de financement appropriés.
L’importance du fonctionnement durable des services d’eau potable n’est plus à démontrer. S’il est acquis que l’accès à cette ressource vitale est une condition essentielle à la santé, au bien-être et au développement économique des populations, il est important de rappeler que dans les milieux ruraux et semi-urbains d’Afrique sub-saharienne, c’est aussi un élément déterminant pour la sécurité et le développement de ces territoires.
LE PRIVÉ, UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE
Pourtant, et contrairement aux milieux urbains, le service de l’eau potable dans les petites villes et les zones rurales n’a jamais été perçu comme économiquement viable. Il est donc resté par défaut à la charge de l’État. Mais en dépit de décennies d’investissements et de programmes successifs de développement, il ne fonctionne toujours pas correctement. Face à une poussée démographique continue et à la demande croissante qui en résulte, la majorité des pays africains peinent à garantir un accès à l’eau potable à leurs populations. Le sous-investissement et l’inefficacité chronique des systèmes de gestion et de maintenance du secteur nécessitent aujourd’hui la mise en place de nouvelles solutions. Face à ces défis, l’intervention du secteur privé apparaît désormais incontournable. Il n’est certainement pas l’unique solution, mais il est difficile d’envisager des solutions durables sans lui. Différents modèles existent, mais encore peu en Afrique de l’Ouest. Le groupe Odial Solutions, à travers ses filiales Vergnet Hydro et Uduma a mis en place depuis plus de 15 ans des modèles économiques viables et adaptés aux contextes locaux. Il a pour cela réalisé plusieurs co-investissements dans le cadre de projets ambitieux, basés sur l’innovation. En s’appuyant sur de nouvelles technologies et une gestion adaptée, le groupe a réussi à fournir des services d’eau potable durables dans des zones où les solutions traditionnelles avaient échoué. Par exemple, Uduma met en place au sein des communautés, quand le contexte le permet, des bornes-fontaines automatiques (BFA) : un appareil de distribution d’eau entièrement autonome, alimenté par un panneau solaire. L’utilisateur se sert simplement de la clé qu’il reçoit en tant que client. Il la crédite afin de pouvoir puiser de l’eau.
DES ATOUTS ADAPTÉS AU CONTEXTE
Le secteur privé dispose de plusieurs atouts : la rigueur dans la gestion, le savoir-faire technique, l’innovation et l’accès à des technologies avancées, et une capacité à accélérer la mise en oeuvre des projets. Ces éléments sont cruciaux pour améliorer l’impact des services d’eau potable ; ils participent aussi à les pérenniser, et à renforcer leur rentabilité. En garantissant la disponibilité des moyens nécessaires à la rémunération des opérateurs, il est possible ainsi d’assurer l’entretien des infrastructures, le renouvellement des équipements et ainsi le fonctionnement en continu du service.
Contrairement au milieu urbain, la dispersion des populations, leurs plus faibles revenus et leurs difficultés à payer pour le service de l’eau font que le modèle en milieu rural et dans les petites villes est plus difficile à équilibrer économiquement. Il est nécessaire de développer des systèmes de gestion et des opérateurs adaptés à ce contexte particulier. À l’inverse des grands services publics urbains, les zones rurales et semi-urbaines nécessitent des petites et moyennes entreprises (PME) capables de s’adapter aux réalités locales. Si elles disposent de moins de moyens et sont plus fragiles, ces structures apportent une flexibilité et une proximité qui sont des atouts majeurs. Leur capacité à intégrer des technologies adaptées apparaît également essentielle dans la réduction des coûts de gestion engendrés par les spécificités du contexte et les populations ciblées. Une attention doit néanmoins être portée à leur capacité à lever les fonds nécessaires au déploiement des infrastructures et pour dé-risquer les pertes potentielles des premières années de services ; même s’ils sont souvent bien inférieurs à ceux requis pour les infrastructures urbaines, ces besoins financiers sont déterminants. Sur les 30 milliards de dollars par an à investir dans le secteur de l’eau, un tiers de ce montant l’est en milieu rural.
CRÉER DES CONDITIONS FAVORABLES
Pour réussir l’implication du secteur privé dans la gestion des services d’eau potable dans les petites villes africaines, il est nécessaire de créer les conditions les plus favorables à sa réussite. Les contraintes économiques doivent être comprises et considérées par l’ensemble des acteurs, et en premier lieu les gouvernements et les bailleurs. Par ailleurs, le cadre réglementaire doit être adapté pour faciliter l’implication du secteur privé tout en protégeant les intérêts des populations ; cela inclut la régulation des tarifs, la protection des ressources et la garantie d’un accès équitable à l’eau potable. Enfin, de nouveaux outils de financement capables de répondre aux spécificités du secteur doivent être développés et déployés : subventions ciblées, prêts à faible taux bonifiés, des partenariats public-privé particuliers et mécanismes de co-financement innovants. L’avenir du secteur de l’eau en Afrique, particulièrement pour les petites villes et les zones rurales, constitue un enjeu crucial non seulement pour le développement économique, mais aussi pour la stabilité sociale, environnementale, politique et sécuritaire du continent. Avec la moitié de la population africaine concernée, ce secteur représente un levier essentiel pour le développement. L’implication du secteur privé, indispensable pour relever ces défis, doit être sérieusement prise en compte et favorisée, à la hauteur des enjeux du secteur.
Auteur(s)
Mikaël Dupuis
Directeur adjoint
UDUMA