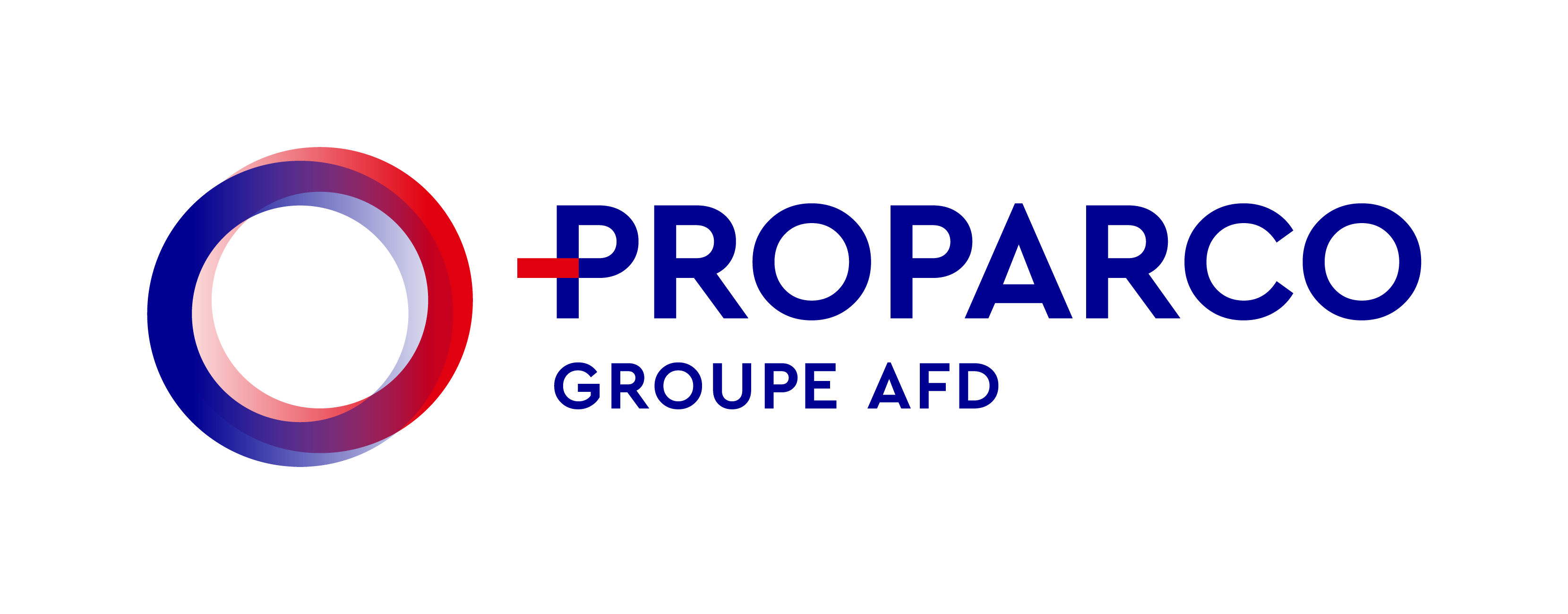Partager la page
L’eau non comptabilisée : une ressource gaspillée, une richesse dilapidée
Publié le
Noam Komy Directeur général Miya Water

Secteur Privé & Développement #42 - Accès à l’eau et à l’assainissement : le secteur privé à la source
Cette revue est consacrée au rôle du secteur privé dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. Un enjeu majeur alors que plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à une eau potable de qualité à domicile, et qu’elles sont 3,5 milliards à ne pas disposer d’un assainissement adapté.
Environ un tiers de l’eau potable fournie aux compagnies de distribution dans le monde se perd avant d’atteindre le consommateur. Cette perte, appelée NRW (pour Non-Revenue Water) – eaux non génératrices de revenus, en français –, est le paramètre le plus crucial dans la gestion d’un service public de l’eau. Elle représente le volume hydrique produit et mis en circulation dans le système de distribution, mais qui ne génère pas de revenus parce que cette eau est soit perdue, soit non comptabilisée avant d’atteindre le consommateur final.
Au niveau mondial, le volume global d'eaux non génératrices de revenus est estimé à 346 millions de mètres cubes par jour, soit plus de 126 milliards de mètres cubes par an. Dans une approche prudente, le ratio coût/valeur de cette eau perdue représente 50 milliards de dollars chaque année. Les pertes physiques sont essentiellement dues à des fuites, aux ruptures de canalisations et au débordement des réservoirs de stockage. Elles s’expliquent par le vieillissement des infrastructures, leur mauvais entretien ou par une gestion inadaptée de la pression. Elles représentent un gaspillage direct de la ressource hydrique, et nécessitent souvent des investissements importants pour les réduire. Les pertes commerciales, également appelées « pertes apparentes », désignent l’eau volée et les prélèvements non autorisés, ainsi que les inexactitudes dans le suivi des consommations. Ces pertes commerciales constituent un défi majeur dans de nombreux pays en développement, où le vol et les branchements illégaux sont monnaie courante. Pour les limiter, il est essentiel de disposer de compteurs précis et d’un solide système de facturation.
POURQUOI LA RÉDUCTION DES PERTES HYDRIQUES EST-ELLE UNE PRIORITÉ ?
Les pertes NRW (pour non-revenue water), eaux non génératrices de revenus, en français ont des conséquences économiques majeures pour les compagnies des eaux. Un niveau élevé de pertes hydriques peut compromettre la viabilité financière d’une société de distribution, en limitant sa capacité à investir dans l’amélioration et le déploiement des infrastructures. Un cercle vicieux se met alors en place, une infrastructure inadéquate entraînant des niveaux de pertes plus élevés, qui réduisent à leur tour les revenus et la capacité d’investissement. Selon un récent rapport de S&P Global, « les pertes en eau peuvent avoir une influence sur la qualité de crédit des services publics de distribution d’eau évalués par l’agence de notation », dans la mesure où elles sont le reflet de la santé opérationnelle globale de l’entreprise. Pour les compagnies des eaux, ces pertes peuvent donc aussi affecter le coût de la dette et avoir un impact négatif sur leur capacité à lever les capitaux nécessaires à l’amélioration de leurs installations.
De nombreux pays en développement connaissent des niveaux élevés de pertes en eau, ce qui les empêche d’approvisionner de façon sûre et fiable leurs populations. Il a été maintes fois démontré que, pour une société de distribution d’eau, le moyen le moins coûteux d’augmenter la capacité consiste à réduire les pertes physiques. Limiter ces pertes permet donc de maximiser la ressource hydrique disponible, et ainsi de différer le besoin d’exploiter de nouvelles sources, réduisant d’autant l’impact environnemental de l’extraction et du traitement de l’eau. En économisant les volumes perdus, on pourrait aujourd’hui alimenter en eau près d’un milliard de personnes supplémentaires dans le monde. Mais les répercussions sociales et environnementales des pertes en eau ne s’arrêtent pas là. Les NRW contribuent en effet aux consommations énergétiques et aux émissions de gaz à effet de serre associées au traitement et au pompage de l’eau. Les services de distribution d’eau comptent en effet parmi les plus gros consommateurs d’énergie, quel que soit le pays, du fait de la nécessité de pompage et de traitement. C’est encore plus vrai dans les pays qui dépendent fortement du dessalement comme principale source d’eau potable. Selon le rapport de S&P, les émissions correspondantes représentent 11,9 millions de tonnes de CO2 par an. En ne limitant pas les pertes en eau, les compagnies de distribution sont ainsi confrontées au double problème de leur approvisionnement hydrique et de leur impact global sur le réchauffement climatique. Enfin, dans les communautés où prévalent des taux élevés d’eaux non génératrices de revenus, il faut souvent faire face à des ruptures d’alimentation et à une moindre qualité de l'eau distribuée, ce qui peut entraîner des problèmes sanitaires.
ATTÉNUATION DES EAUX NON-GÉNÉRATRICES DE REVENUS : COMPLEXITÉS ET DÉFIS
Sur le papier, la réduction de ces pertes peut apparaître comme une tâche simple à mettre en oeuvre. Malheureusement, la réalité et bien plus ardue et complexe. Il n’est pas rare que l’organisation ait du mal à reconnaître le problème : beaucoup de compagnies des eaux ne veulent pas affronter cette réalité. Admettre que l’on perd plus de 50 % de l’eau produite, par exemple, constitue un défi psychologique, professionnel et politique. De plus, seuls un nombre limité de projets de réduction d’eaux non génératrices de revenus ont été menés à bien à ce jour : le manque d’expérience est réel. Les réductions de pertes se heurtent aussi aux idées reçues et aux perspectives de court terme. Beaucoup de sociétés de distribution continuent de croire que l’on peut remédier au manque d’eau en produisant davantage. Naturellement, lorsqu’un système hydrique perd une part importante de son alimentation en raison de fuites, le fait d’ajouter de l’eau dans le réseau ne résout pas le problème, cela peut même l’aggraver. Une autre erreur fréquente consiste à penser que le seul moyen de lutter contre les pertes est de mettre en place un programme massif de remplacement des canalisations. Une absence d’orientation claire, de définition d’objectifs et de stratégie cohérente est souvent au coeur des difficultés rencontrées dans les programmes de lutte contre les pertes. La plupart des acteurs du secteur traitent les problèmes d’eaux non génératrices de revenus en attaquant les sujets séparément, avec une coordination insuffisante entre des tâches et des travaux distincts, et sans s’assurer au préalable que l’organisation oeuvre collectivement à la réalisation d’un objectif commun.
OBTENIR DES RÉSULTATS GRÂCE À DES CONTRATS BASÉS SUR LA PERFORMANCE
Les contrats basés sur la performance (PBC pour performance-based contracting) constituent une approche innovante pour la gestion des pertes en eau. Dans le cadre d’un PBC, la compagnie de distribution engage un prestataire privé pour réduire ses pertes, et la rémunération du contractant est directement adossée à la performance réalisée. Cela permet d’aligner l’incitation financière du prestataire sur les objectifs de la compagnie de distribution, en veillant à ce qu’il soit correctement motivé pour parvenir à une réduction substantielle et durable des pertes d’eaux non génératrices de revenus. Un PBC comprend généralement des objectifs de performance spécifiques, par exemple un volume donné d’eau économisée. Un contrat basé sur la performance repose tout d’abord sur des objectifs clairs et quantifiés, donc mesurables. Ils doivent être établis en se fondant sur une évaluation rigoureuse des niveaux existants d’eaux non génératrices de revenus et sur leur potentiel de réduction. Les valeurs cibles peuvent comporter des jalons à court terme et des objectifs à plus long terme, afin de garantir une amélioration continue.
Il faut aussi que le contrat privilégie une approche fondée sur les résultats, le plus important d’entre eux étant la réalisation d’économies réelles, bien entendu. De ce fait, un PBC bien conçu doit laisser au prestataire suffisamment de latitude dans les méthodes employées pour atteindre les objectifs. La plupart des compagnies des eaux ont pour habitude de recourir à des contrats basés sur des devis ex ante, où elles achètent une liste de prestations spécifiques. Cela n’autorise pas assez de souplesse, et tend à accroître l’investissement en capital au lieu d’utiliser des moyens moins coûteux pour améliorer les performances du système. Par ailleurs, il faut lier une part importante de la rémunération à la performance. Plus le prestataire dispose de souplesse, plus le risque qu’il est prêt à assumer est élevé. La compagnie des eaux devra donc chercher à maximiser la part de rémunération fondée sur la performance, par opposition aux honoraires fixes, et assurer que le prestataire privé ne réalisera aucun bénéfice s’il n’atteint pas les résultats souhaités. Enfin, il est indispensable de mettre l’accent sur la qualité dans la sélection du prestataire. La compagnie des eaux doit s’assurer que la mise en concurrence ne concernera que des prestataires compétents, disposant à la fois de l’expérience nécessaire et d’un plan solide, bien pensé.
UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE
Les contrats basés sur la performance constituent un moyen innovant et efficace basé sur un système incitatif, permettant de partager les risques, et d’atteindre une réduction durable des pertes en eau. L’étude de démarches réussies partout dans le monde, y compris dans le cadre de projets conduits par Miya Water, témoigne d’un potentiel d’amélioration significative dans la gestion d’eaux non génératrices de revenus. L’avenir des démarches de réduction des pertes hydriques repose sur l’intégration de technologies de pointe, sur les efforts de collaboration, l’existence de politiques de soutien, le renforcement des capacités et la prise en compte des enjeux de développement durable et de résilience climatique. En engageant ces différentes mesures, les compagnies de distribution d’eau pourront assurer une utilisation efficace et durable des ressources, améliorer leur qualité de service, et contribuer au bien-être des communautés et à la préservation de l’environnement
Auteur(s)
Noam Komy
Directeur général
Miya Water