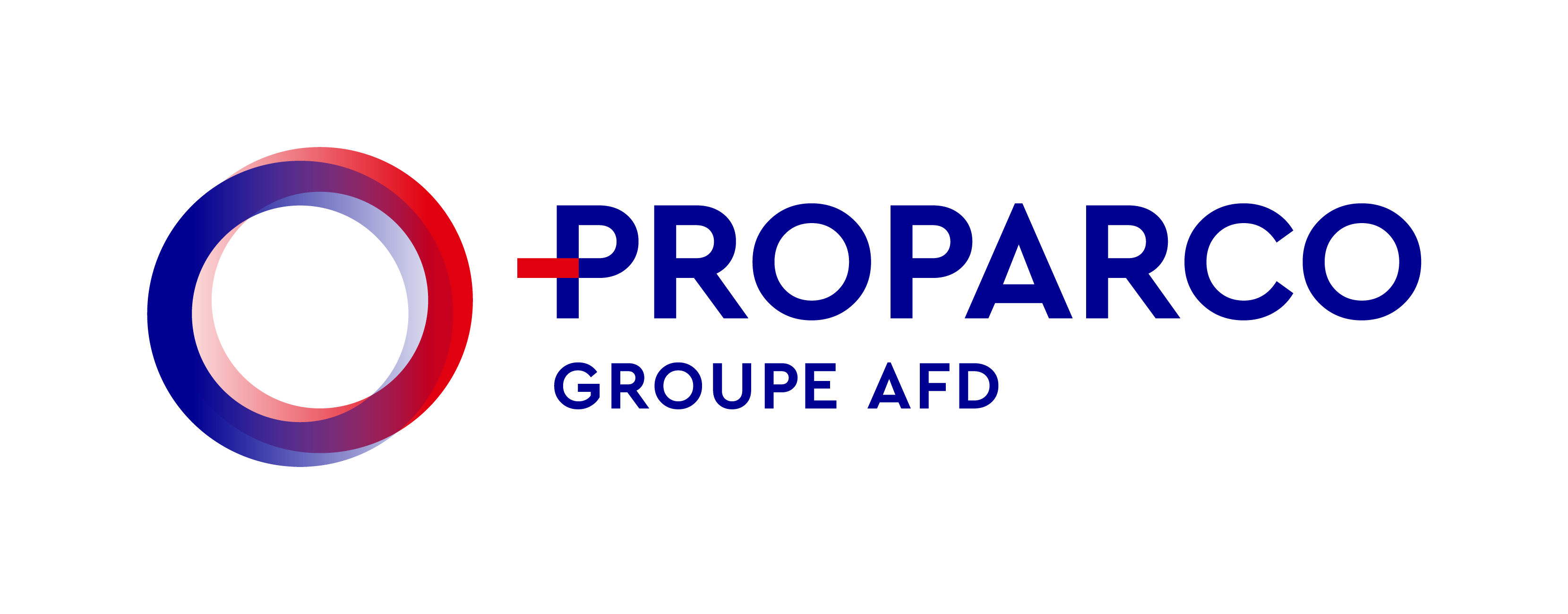Partager la page
Eau et assainissement : comment favoriser l’investissement privé ?
Publié le
Sophie Trémolet Responsable de l’équipe Eau OCDE

Secteur Privé & Développement #42 - Accès à l’eau et à l’assainissement : le secteur privé à la source
Cette revue est consacrée au rôle du secteur privé dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. Un enjeu majeur alors que plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à une eau potable de qualité à domicile, et qu’elles sont 3,5 milliards à ne pas disposer d’un assainissement adapté.
Pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), il est essentiel de favoriser la participation du privé dans le secteur de l’eau. Les exemples de réussite ne manquent pas. Toutefois, parce que les niveaux d’investissement restent faibles, il convient, pour accroître cette participation, de clarifier dès le départ les attentes des parties contractantes, et de mettre en place un environnement propice (notamment sur le plan réglementaire).
En 2015, l’OCDE et le Conseil mondial de l’eau avaient identifié les besoins en investissement pour atteindre l’ODD n° 6, qui porte sur l’eau et l’assainissement, les estimant à des niveaux allant de 6 700 milliards de dollars d’ici 2030 à 22 600 milliards de dollars d’ici 2050. La Banque mondiale a récemment établi que les pays en développement devraient tripler les investissements actuels pour atteindre l’ODD n° 6, et que la part du secteur privé dans ces dépenses n’étaient que de 2 % actuellement. En Europe, le secteur privé est de longue date un investisseur plus constant, mais sa part du financement total ne représente cependant pas plus de 6 %.
DÉFICIT DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ
Pour atteindre les ODD 6.1 et 6.2 (accès universel à l’eau potable et à l’assainissement), 6.3 (traitement des eaux usées) et 6.4 (utilisation plus efficace de l’eau), il faudra des investissements initiaux considérables. Une fois les réseaux et les unités de traitement en place, des dépenses d’exploitation, de maintenance et de mise en conformité aux évolutions réglementaires seront en outre nécessaires. Les pays de l’Union européenne (UE) devraient accroître leurs investissements en moyenne de 25 % entre 2020 et 2030, chiffre qui passe à 100 % pour les pays ayant rejoint l’UE plus récemment – et ce, pour rattraper leur retard et s’aligner sur les exigences européennes.
La part des investissements privés dans des projets d’infrastructures liées à l’eau, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, a oscillé entre 2 et 10 % du total des investissements privés entre 2014 et 2023. Le volume des investissements privés dans le secteur et le nombre de projets faisant intervenir des financements privés sont ainsi passés de 5,3 milliards de dollars pour 27 projets en 2022 à 1,8 milliard de dollars pour 19 projets en 2023. À l’inverse, sur la même période, le volume des projets énergétiques – principalement d’énergies renouvelables – ont nettement dépassé leurs niveaux d’avant la crise du Covid, l’investissement privé dans les pays à revenus faibles et intermédiaires atteignant dans ce domaine 62,4 milliards, pour 187 projets.
Ce déficit d’investissement privé s’explique notamment par la faiblesse persistante des tarifs pratiqués – souvent maintenus, pour des raisons politiques, à des niveaux inférieurs à leur coût de revient – et par le nombre limité de projets susceptibles de faire l’objet d’un investissement. Cette situation est toutefois en train d’évoluer, car les effets du changement climatique (inondations, sécheresses et feux de forêt) ont des répercussions sur l’eau. Avec l’appui d’institutions de financement du développement, beaucoup de gouvernements se tournent vers le secteur privé. Il faut néanmoins rester réaliste quant au rôle que le secteur privé peut et doit jouer pour assurer la sécurité de l’eau à l’avenir. L’accent doit être mis désormais sur la bonne manière de faire les choses, afin d’éviter les écueils du passé.
UN PARTAGE DES RISQUES ADAPTÉ ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVÉ
Tout d’abord, il convient de faire évoluer les tarifs pour qu’ils puissent couvrir les coûts (avec des mesures de redistribution pour lutter contre les inégalités). Il faut également attribuer des zones de service bien définies et adaptées aux opérateurs – sachant qu’elles sont souvent fragmentées (au Bénin par exemple) et parfois trop vastes (dans les pays de l’ex-Union soviétique).
Deuxièmement, un partage adapté des risques entre secteur public et secteur privé s’impose. Certaines attentes irréalistes à l’égard du secteur privé persistent depuis le début des années 1990, moment où une bonne part des grands contrats de concession de référence ont été signés. La volonté d’investir des opérateurs privés dans le secteur de l’eau s’est sérieusement émoussée lorsque certains contrats de concession ont été touchés par l’instabilité économique et politique et, au bout du compte, résiliés (à Buenos Aires en 2006 ou au Gabon en 2018, par exemple). Pour bâtir la confiance entre partenaires publics et privés, il faut donc introduire de façon progressive la participation du privé, en commençant par des contrats de service et de gestion, tout en protégeant les revenus du secteur privé des fluctuations de tarification.
Troisièmement, pour attirer la participation du secteur privé, il faut un environnement favorable et adapté. Outre la mise en place de solides politiques sectorielles pour l’eau, cet environnement doit comporter des indicateurs de stabilité économique et la garantie que les politiques relatives à l’agriculture ou à l’industrie n’auront pas d’effets néfastes sur la sécurité de l’eau. Le leadership politique des gouvernements est également requis pour assurer que les ministères et les agences indépendantes travaillent à la réalisation d’objectifs communs. L’OCDE a développé un outil, destiné à évaluer un environnement pour sa capacité de facilitation des investissements dans le secteur de l’eau, qui a été testé dans plusieurs pays d’Asie, notamment en Arménie – où il a permis d’identifier les réformes nécessaires. En outre, il est essentiel de disposer de cadres juridiques clairs pour la participation du secteur privé (comme par exemple la loi BOT aux Philippines).
Enfin, une bonne coordination du cadre réglementaire est indispensable. Au-delà de la fixation des tarifs et de la mise en place de normes de performance axées sur les résultats, les démarches environnementales doivent également être encouragées et intégrées aux réglementations afin de servir des objectifs climatiques plus larges. L’OCDE et l’AFD travaillent actuellement à une publication sur ce thème, qui paraîtra en début d’année 2025.